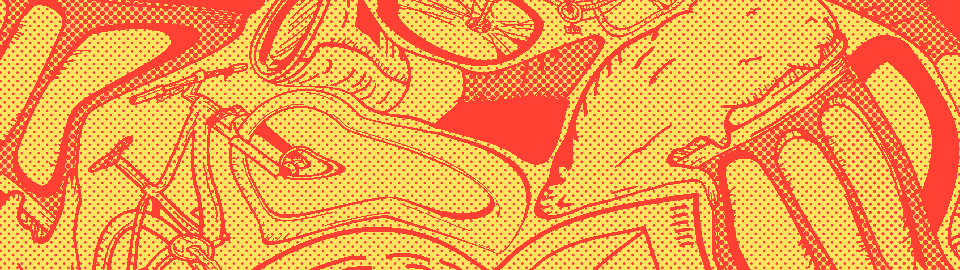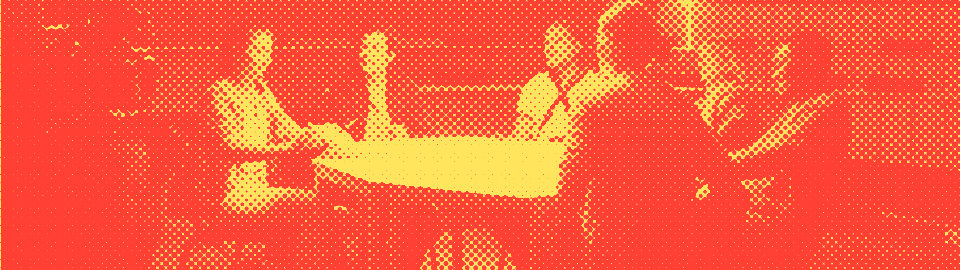Petit Lexique
Pour nous éclairer sur la question des modes d'organisation démocratique au sein de l'entreprise, Quentin Mortier a produit un "Petit lexique critique" sur les formes de réappropriation collective du travail. En voici une sélection dans une version remaniée par le CVB. L'analyse complète est disponible en cliquant ici .
Quentin Mortier est animateur en Éducation permanente et co-directeur de SAW-B.
SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxellois) est une association qui promeut et accompagne le renouveau des pratiques économiques qu'incarne l’économie sociale.
De la lutte sociale à l’autogestion
Dans Demain l’usine (Clara Teper, 2016), les ancien·ne·s employé·e·s du groupe Unilever réinvestissent leur ancienne usine de thé marseillaise Fralib et décident du nom d’un nouveau produit : « 1336 », soit le nombre de jours de lutte qu’iels ont accumulés. Cette expérience de coopérative n’est pas nouvelle. D’autres documentaires, comme Le Balai libéré (Coline Grando, 2023), ou Les LIP, l'imagination au pouvoir (Christian Rouaud, 2007), donnent à voir certains exemples emblématiques des années 70. Dans ces deux films, la classe ouvrière s’émancipe de sa hiérarchie pour s’organiser horizontalement, le temps d’une grève ou bien d’une décennie, au sein d’une coopérative de nettoyage ou d’une usine de montres, mais avec comme dénominateur commun le combat social comme autonomisation. Ces fenêtres locales et historiques ne sont finalement que le symptôme d’un métabolisme plus vaste, celui d’un réseau protéiforme et composite dont on peine encore à résumer l’impact autrement qu’en faisant la liste de ses nombreuses ramifications. En Belgique notamment, les initiatives sont multiples , se référant explicitement ou non à l’autogestion : en santé (les Maisons médicales), en cinéma (Les Grignoux), en éducation (l’association Barricade), en écologie (le Groupe Terre ou La Récupérathèque), en habitat (Communa), en alimentation (Beescoop).
Une définition
Le dictionnaire Larousse définit l’autogestion comme la « gestion d'une entreprise par l'ensemble du personnel, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants élus et révocables par eux-mêmes » et par extension, « la gestion d'une collectivité par elle-même ». Ce que cette définition ne dit pas, c’est que dans certains cas, les travailleur·euse·s deviennent les propriétaires de leur entreprise.
Une citation
« Et nous, justement, ce que nous voulons, c’est que le travail nous appartienne. L’autogestion, ce pourrait être cela : se réapproprier le travail et réintroduire sur le lieu de la production des règles de fonctionnement qui ailleurs nous semblent, non seulement aller de soi, mais fondamentales : liberté de choix, égalité des citoyens, fraternité et solidarité... Ce difficile pari restera impossible si nous ne changeons pas les règles du jeu, si nous nous obstinons à croire qu’on pourra vivre le travail différemment tant que la suprématie du marché et du profit continuera d’imposer leurs logiques aux politiques économiques des gouvernements, aux stratégies des entreprises et à nos esprits acculturés par deux siècles d’idéologie mercantiliste. C’est donc le moteur même de la machine économique qu’il faut débrayer – sauf à se contenter de quelques gadgets optionnels qui nous donneraient l’illusion que le développement et la croissance bénéficient finalement à tous et à chacun. » Michel Lulek, Scions...travaillait autrement ?, Ambiance Bois, l’aventure d’un collectif autogéré, Editions REPAS, 2009 (lisible sur le site des Editions REPAS
Un paradigme de démocratie directe
La notion d’autogestion est indissociable de son échelle : de l’expérience démocratique en entreprise jusqu’au paradigme d’une application aux dimensions d’un territoire (commune, région, nation), sa définition en devient alors aussi délicate qu’elle multiplie les formes, les niveaux, les domaines d’exercice.
Dans cette nomenclature polarisée, on peut dans un premier temps identifier l’autogestion comme le procédé d’un nouveau modèle d’organisation politique de la société. Il s’agit alors d’imaginer une autre forme de démocratie que le régime représentatif auquel nous sommes habitués. Plutôt que de donner nos voix à celles et ceux qui gouverneront à notre place, on leur prêterait la possibilité de « participer aux décisions elles-mêmes »1, laissant apparaître le moyen d’une véritable démocratie directe.
Dans une seconde grande acceptation, l’autogestion concerne un système d’organisation du travail où les travailleur·euse·s sont également propriétaires de l’entreprise. Iels y sont à la fois sociétaires (et donc décideur·euse·s, employeur·euse·s) et bénéficiaires (employé·e·s). Un réaménagement dont l’impact n’est pas seulement une abolition de la verticalité dans le monde professionnel, car il pose plus généralement la question de l’incidence de l’ultralibéralisme sur nos modes de vie. D’abord en réécrivant la notion de sens au travail de par la suppression ou l’amoindrissement de la relation de subordination, mais aussi en ouvrant de nouvelles potentialités dans des domaines comme la gestion de ressources en commun résultant souvent de ce type de démocratie.
Société autogérée, une utopie?
Dans Voyage en misarchie (Emmanuel Dockès, Editions du Détour, 2017), un juriste est parachuté dans une société fictive où les rapports de pouvoir et de domination ont été réduits à leur minimum dans tous les champs possibles où ils se manifestaient : la famille, l’éducation, les migrations, ou encore la monnaie. Elle est autogouvernée et les entreprises y sont autogérées. Les détenteur·trice·s de capitaux n’ont de pouvoir que s’iels sont elles·eux-mêmes travailleur·euse·s, et ils n’ont aucune préséance sur les revenus générés par l’activité de l’entreprise qui sont réservés au remboursement des dettes, à des réinvestissements, ou à des augmentations de salaires. Ce fonctionnement entrepreneurial démocratique n'est pas très éloigné de ce qui existe déjà au sein de certaines coopératives, mais leurs dimensions demeurent dérisoires face à l’hypothèse de l’application de ces principes à la société toute entière.
-
Starhawk, Quel monde voulons-nous ?, Cambourakis, 2019, p. 163. ↩
S’affranchir de la concurrence
Au point de départ du conflit social qui secoue le groupe Delhaize depuis début 2023, un plan de franchise de ses supermarchés qui est venu se heurter à une vive opposition des syndicats. Un changement de modèle économique que l’enseigne justifie par un alignement sur la concurrence, mais qui menace pourtant de déstabiliser les conditions de travail de son personnel.
Néanmoins, cette quête du profit par les actionnaires au détriment des travailleur·euse·s n’est en rien une fatalité. Même si la disparition des commerces de proximité des villes et villages n’aura fait qu’accélérer un processus d’uniformisation des régimes socio-économiques de ce type d’entreprise, la tendance est aussi à la mise en place d’alternatives. Qu’il s’agisse de supermarchés coopératifs et participatifs, de réseaux de circuits courts alimentaires, ou même d’un nouveau genre de commerces de proximité, nombreux sont celles et ceux qui entendent proposer de nouveaux modèles de distribution, qui s’apparentent bien souvent au cadre de la coopérative.
Avec l’inflation, certaines de ces initiatives peinent toutefois à fédérer une population au pouvoir d’achat sans cesse diminué. Plus généralement, la construction de véritables alternatives autonomes à la grande distribution est freinée par les besoins concurrents et contradictoires des acteurs de cette réorganisation : la qualité et le sens du travail des travailleur·euse·s, l’accessibilité financière des produits alimentaires, le niveau de rémunération et l’autonomie des producteur·rice·s, les impacts environnementaux, l’expérience et le pouvoir des consommateur·rice·s (proximité, convivialité).
Une définition
L’Alliance coopérative internationale définit la coopérative comme « une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. »
Une citation
« Les coopératives sont porteuses d’une autre conception de la propriété. Mais elles peuvent aussi se mouler dans l’imaginaire entrepreneurial. Une pensée embellissant la coopérative peut réactiver à tout moment l’idéologie selon laquelle la présence d’une entreprise non capitaliste suffirait à changer le monde. Les deux derniers siècles nous enseignent que c’est faux. Les coopératives se sont banalisées quand elles ont considéré que la seule propriété collective valait fonctionnement démocratique ; pour sa part, la référence à l’autogestion s’est brouillée quand elle est devenue un slogan. Les règles propres à la coopérative, comme la référence à l’autogestion, sont à considérer non comme des points d’arrivée mais comme des points de départ ouvrant sur des chemins qui ne sont pas balisés à l’avance mais demandent à être arpentés par et avec des personnes impliquées. En somme, suspendre l’usage de termes trop flou comme coopérative ou autogestion est probablement une étape nécessaire à la description fine des pratiques qui s’en réclament. C’est dans les assemblages qui les concrétisent que nous devons les éprouver sans préjuger du contenu auquel ils devraient correspondre. La singularité de chaque expérience tient à ce qu’elle est par certains aspects émancipatrices, voire émancipée, et par d’autres normalisée. C’est cet écheveau qu’il importe de démêler dans les coopératives […]. »
Bruno Frère et Jean-Louis Laville, La fabrique de l’émancipation. Repenser la critique du capitalisme à partir des expériences démocratiques, écologiques et solidaires, Seuil, 2022.
La coopération face à l’économie de marché
Si penser la coopération comme le socle idéologique de la vie courante des coopératives semble indissociable de la nature profonde de ce type d’organisation, le chercheur Jacques Pradès 1 en distingue pourtant plusieurs approches. La première, celle d’un cadre intra-coopératif, concerne la structure interne d’un projet : l’association d’un groupe de personnes hétérogènes autour d’une œuvre commune, fondée sur une égalité supposée entre ses différents membres.
La seconde, inter-coopérative, prend un peu plus de hauteur et s’intéresse aux relations établies entre différentes entités autour d’un même objectif : plus simplement, il s’agit de la coopération entre les coopératives. Face à ces deux définitions s’interpose un obstacle pragmatique : comment soutenir la prévalence d’une finalité sociale dans une économie de marché où priment normalement la concurrence et les intérêts individuels ?
Un début de réponse est corrélé à la troisième approche de cette idée de coopération : par extra-coopératif on entend le rapport entre un collectif d’acteurs et un cadre légal, réglementaire, national ou supranational, qui régule les rapports entre producteur·rices, consommateur·rices et distributeur·rices. C’est en s’associant qu’ils ont la possibilité d’influer sur les lois, les pratiques, de faire bouger les lignes et donc de pouvoir véritablement agir socialement. C’est d’ailleurs là son paradoxe, car si la coopérative œuvre pour une transformation sociétale, elle-même dépend d’un changement socio-politique qui n’a pas encore commencé.
Vers un réseau coopératif ?
Le projet politique, dans la France de la fin du XIXème siècle, d’une « République coopérative », imaginait la transformation de la société via l’agrégation des différentes formes de coopératives, et donc de leurs parties prenantes respectives : travailleur·euses, consommateur·rices et producteur·rices.
Plus récemment, aussi en France, la mise en place des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) entreprend de porter encore plus loin les critères ordinaires de l’économie sociale, notamment à travers le multisociétariat (l’association des salarié·e·s, des bénéficiaires et d’un autre contributeur au projet, parmi lesquels peuvent se trouver les collectivités publiques locales), un fort ancrage territorial et la recherche d’une utilité sociale. Neuf de ces SCIC se sont rassemblées au sein du collectif des Licoornes (qui détourne le terme de « licorne » qui désigne une startup valorisée à plus d’un milliard de dollar), qui réunit un fournisseur d’électricité, un opérateur télécom, une plateforme de covoiturage, un fournisseur d’appareils électroniques éco-conçus, une coopérative bancaire éthique, une plateforme coopérative de circuit court, un opérateur ferroviaire et un site de e-commerce de seconde main.
-
Jacques Pradès, « Du concept d’innovation sociale » dans RECMA, n° 338, 2015, repris notamment dans SAW-B, Et si nous coopérions ?, étude 2016, disponible sur www.saw-b.be. ↩
Libération et hiérarchie
« Chouchou revient, elle a bien mangé, elle dit vous avez eu le temps de faire quoi pendant que j’étais partie ? Nous sommes trois en salle et elle nous attribue des tâches parce que sinon, on ne sait pas comment s’occuper. [...] Chouchou a peur que je m’ennuie alors elle me propose des activités, faire un tour de balayette, changer les poubelles comptoir, elle veut savoir si ça ne me dérange pas de nettoyer les toilettes. Je n’ai pas le temps d’y aller qu’elle se tourne vers une autre équipière et lui dit mais c’est pas possible, tout le monde sait le faire pourquoi pas toi ? Si je t’évalue, je te mets même pas la moyenne, changer une poubelle en plein rush c’est n’importe quoi. Comme elle ne connaît pas mon prénom, elle ne m’apostrophe pas et quand elle n’en peut plus, qu’en enfant a renversé une boisson, elle m’appelle la miss. »
Chouchou, c’est le surnom de la manageuse et formatrice d’un établissement d’une chaîne de restauration rapide dans le livre En Salle (Claire Baglin, Editions de Minuit, 2022), roman autobiographique où la narratrice croise sa propre expérience professionnelle à celle du souvenir qu’elle a de son père ouvrier.
Ces scènes, normalisées dans de nombreux emplois, ont pourtant motivé des entreprises dites « libérées » à essayer de s’en défaire : suppression de certains échelons hiérarchiques, autonomie et prise de responsabilité des travailleur·euse·s, inversion de la relation entre management et employé·e·s. En Belgique, certains magasins Décathlon se sont organisés de la sorte, de même dans certains services publics comme le SPF Mobilité.
Une définition
Une entreprise libérée est définie par Isaac Getz et de Brian Carney comme : « une forme organisationnelle dans laquelle les salariés sont totalement libres et responsables dans les actions qu’ils jugent bon d’entreprendre »1. Les entreprises libérées sont présentées par l’un de ses hérauts, Jean-François Zobrist, directeur de l’entreprise libérée Favri, comme opposées aux entreprises taylorisées, basées sur le contrôle et la division du travail, et désignées comme des « sociétés comment », qui consacrent beaucoup de temps à expliquer aux salariés comment précisément faire leur travail. Les entreprises libérées seraient des « sociétés pourquoi », qui privilégient la finalité et donc le sens de ce travail.
Une citation
« Le mouvement des entreprises libérées apparaît ainsi comme une des têtes de l’hydre managériale qui sans cesse repense et rejoue sur différentes tonalités l’exercice de la domination des salariés. Qui jamais ne renonce à la manne de la subordination pour inventer les modes les plus efficaces de réalisation des profits. Qui toujours a la prétention d’innover pour le plus grand bien de tous en reconnaissant les erreurs du passé. […] De la modernisation des années 1980 (véhiculant les valeurs de l’humanisme, du bonheur, de la réalisation de soi et de l’éthique, tout en veillant à concrétiser la subordination par des prescriptions omniprésentes), aux entreprises libérées unilatéralement par leur leader (qui choisit très personnellement en quoi consistera cette libération en fonction de ses propres objectifs), on voit avec quelle constance le caméléon managérial avance, de quoi le boa managérial se nourrit. Il parvient à prendre de cours toutes les critiques par une accélération du changement et une rhétorique bien huilée fondée sur une succession de mea-culpa. Les salariés, pris dans une relation personnalisée et solitaire à leur travail dans un contexte de marché du travail tendu, semblent de leurs côtés désireux d’y croire et toujours prêts à s’investir dans un nouveau pacte de Faust… ».
Danièle Linhart, L’insoutenable subordination des salariés, ERES, 2021.
Une vision idéalisée du changement social
L’expérience des entreprises libérées synthétise une évolution des moyens mis en œuvre par celles-ci, mais pas de leurs fins. Elles tentent de redonner du sens au travail par les zones d’autonomie qu’elles concèdent aux employé·e·s (en prenant en compte un besoin inhérent de créativité au travail), sans toutefois remettre en cause le monopole de la pensée capitaliste sur les finalités de leur activité. Du point de vue de l’économie sociale et solidaire, le phénomène des « entreprises libérées » est considéré comme une illustration de la capacité des acteurs capitalistes à prendre en compte et à intégrer les critiques dont ils font l’objet. De ces exemples se diffuse alors une vision idéalisée et simpliste du changement social : des entrepreneurs autoproclamés « leaders libérateurs et sans ego » qui évitent de remettre en question le rôle du marché dans la vie de l’entreprise.
La vraie entreprise libérée
« La vraie entreprise libérée, c’est celle qui s’est libérée du principe de la propriété financière (...) et qui se réordonne sur une base explicitement politique, c’est-à-dire démocratique »2. La critique des entreprises libérées l’analyse comme une opération managériale ne remettant pas en cause le pouvoir des détenteurs du capital.
C’est une forme d’entreprise sans propriétaire, indépendante du pouvoir des actionnaires, dont les fonds propres seraient accordés par un système bancaire financé et géré par la population d’un pays, qui tend davantage à dessiner les contours d’un modèle véritablement « libéré ». Cet approfondissement de pratiques déjà existantes (comme les coopératives) va plus loin qu’un simple changement organisationnel de la structure d’une entreprise : il admet une véritable transition institutionnelle du cadre dans lequel elles évoluent.
S’unir pour mieux régner
Avec la mise en place de l’Assemblée citoyenne pour le climat à Bruxelles, ce sont cent personnes tirées au sort chaque année qui vont débattre et soumettre des recommandations au gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. Un exemple pas vraiment inédit alors que se multiplient des dispositifs similaires se basant sur l’hypothèse de l’intelligence collective d’un groupe : face à une problématique complexe, un collectif de personnes coopérant entre elles sera plus efficace qu’une personne seule ou qu’un collectif de personnes n’interagissant pas entre elles.
Si ces projets sont parfois à l’initiative d’élus, nombreux sont les mouvements citoyens qui ont marqué la décennie passée avec leurs revendications d’une démocratie plus équilibrée : les Indignados espagnols, Occupy Wall Street, Nuit Debout ou encore le référendum d’initiative citoyenne réclamé par les Gilets Jaunes. Plus récemment, en Belgique, c’est un collectif d’associations qui s’est réuni sous la bannière « Il faut qu’on parle » avec comme objectif le lancement d’un débat citoyen ayant pour but de réformer le financement des partis politiques.
Cette théorie de l’intelligence collective s’est progressivement insinuée au sein d’organisations de différentes tailles, associations comme entreprises, via la sociocratie ou l’holacratie, des méthodologies de gouvernance qui ont conceptualisé une mécanique de prise de décision collégiale à travers la définition d’objectifs partagés. Si l’ampleur des mouvements militants dépasse de loin les applications habituelles de la sociocratie, ils partagent les mêmes préoccupations : celle de dépasser la délégation du pouvoir pour mieux décider ensemble.
Une définition
L’intelligence collective est définie par Olfa Gréselle-Zaïbet comme « l’ensemble des capacités de compréhension, de réflexion, de décision et d’action d’un collectif de travail restreint issu de l’interaction entre ses membres et mis en œuvre pour faire face à une situation donnée présente ou à venir complexe » 1. Selon Wikipedia, la sociocratie est un mode de gouvernance partagée qui a pour objectif de permettre « à une organisation, quelle que soit sa taille, de fonctionner efficacement selon un mode auto-organisé caractérisé par des prises de décision distribuées sur l'ensemble de la structure ». La dimension opérationnelle de celle-ci a connu de nombreux développements, avec une diversité d’outils et de méthodes qui visent à instaurer égalité et coresponsabilité.
Une citation
« Peut-on trouver dans des méthodes comme la sociocratie, l’holacratie, les pratiques contributives ou la décision par consentement des pistes utiles à cette quête de l’autonomie ? Oui, sans aucun doute, mais à la condition d’y recourir comme moyens de l’autonomie, et non comme moyens du management ! Or, les «sciences» du management ont cette capacité depuis les années 50 à présenter comme toujours neuves les mêmes pratiques dont le faux nez est aimable et le visage sordide. Des « cercles de qualité » au «management spaghetti», du « lean manufacturing » aux « entreprises libérées », du « toyotisme » aux « organisations opales », c’est toujours la même tartufferie visant à rejeter les organisations pyramidales et hiérarchisées au profit de modes de production agiles faisant la part belle à la responsabilité des «acteurs». L’autonomie qui y est promue n’est qu’un discours de façade qui masque la simple manipulation, dans une logique de management, de la bonne volonté et de la conscience professionnelle des travailleur·ses. […]
La sociocratie fait sans doute exception dans la longue liste des tartufferies managériales, dans la mesure où elle est avant tout issue d’une réflexion pédagogique portée par le néerlandais Kees Boeke (1884-1966). De sa pratique en classe, Boeke avait tiré trois règles d’animation : prendre les intérêts de chacun·e en considération, n’adopter de décision que si elle est pleinement acceptée par celles et ceux qui l’appliquent, et veiller à la mise en œuvre par toutes et tous des décisions prises unanimement. […] »
Stéphane Veyer, « La coopération contre le management », dans Jean-François Draperi, Frédéric Dufays, Sybille Mertens, Stéphane Veyer, Carmelo Virone (dir.), Les coopératives entre management et contre-management, Smart, 2021.
Réinventer la délibération démocratique
Au sein d’un collectif, les deux pratiques les plus répandues pour les prises de décision sont sans doute le vote (la majorité impose ses idées) et l’unanimité (la minorité peut bloquer une décision). Face à cette problématique, la sociocratie énonce une troisième voie possible : chacun·e a le pouvoir de s’opposer à une proposition s’iel ne peut pas « vivre avec » celle-ci, avec la condition d’exprimer une objection raisonnable et motivée. Le collectif se doit alors d’améliorer ladite proposition pour satisfaire toutes les objections. Mais si aucune solution n’est trouvée, un groupe de travail devra réviser le projet en question. Ces groupes se divisent en différents cercles dont chacun réunit des personnes partageant une mission commune : autonomes pour certaines décisions, ils interagissent entre eux quand cela est nécessaire.
Inspirée de la sociocratie, l’holacratie a d’abord été développée et déposée comme marque par une entreprise américaine de production de logiciels informatiques. Dans le mode de management qu’elle formule, ce sont des « rôles » qui structurent l’organisation, dont l’attribution d’un objectif clair rappelle les « cercles » de la sociocratie.
L’origine de l’holacratie, comme de la sociocratie, est donc à situer dans des organisations aux ambitions capitalistes, où les visées démocratiques et sociales d’une supposée intelligence collective ne semblent alors pas forcément compatibles avec leur modèle économique. On peut alors en interroger les fondements. Elles ont pourtant ceci d’intéressant qu’elles proposent des méthodologies à des collectifs dont la logique de la participation démocratique (« une personne = une voix ») est vue comme insuffisante pour atteindre une véritable égalité d’accès aux délibérations et aux prises de décision. Même si les réponses qu’elles apportent ne sont pas adaptées à toutes les situations, elles interrogent la place que l’on donne à un consensus au sein d’un groupe donné.
L’égalité présupposée
Dans Aux bords du politique (Jacques Rancière, Gallimard, 2004), Jacques Rancière fait une distinction entre la et le politique. La politique serait l’activité consistant à « organiser le rassemblement des hommes en communauté, distribuer hiérarchiquement des places et des fonctions et obtenir leur consentement ». Ce processus assigne aux individus une place dans un ordre déjà construit. Le politique est, quant à lui, « le jeu des pratiques guidées par la présupposition de l’égalité de n’importe qui avec n’importe qui ». Dans cette approche, qu’il qualifie lui-même d’émancipation, l’égalité est considérée comme un présupposé, un point de départ, et non comme une ligne d’arrivée à atteindre. Chacun a la possibilité, dans différentes situations, de mettre à profit une capacité potentielle parfois encore inconnue. Les places et les compétences assignées aux individus sont alors redistribuées.
Jacques Rancière rattache ce monde égalitaire à divers exemples historiques d’émancipation par des changements de mode de vie : l’alphabétisation des ouvriers du début du XIXème siècle qui se mettent à lire et écrire de la poésie, le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis où des citoyens afro-américains vont braver pour la première fois les interdictions qui leur étaient imposées, les manifestations des femmes iraniennes en 2022 brûlant leur hijab au péril de leur vie. Rancière formule alors que ces nouvelles capacités ne sont pas une perspective future mais pourraient surgir chez n’importe qui à tout moment, « ici et maintenant ».
-
Olfa Gréselle-Zaïbet, « Vers l'intelligence collective des équipes de travail : une étude de cas », dans Management & Avenir, vol. 14, no. 4, 2007, pp. 41-59. ↩